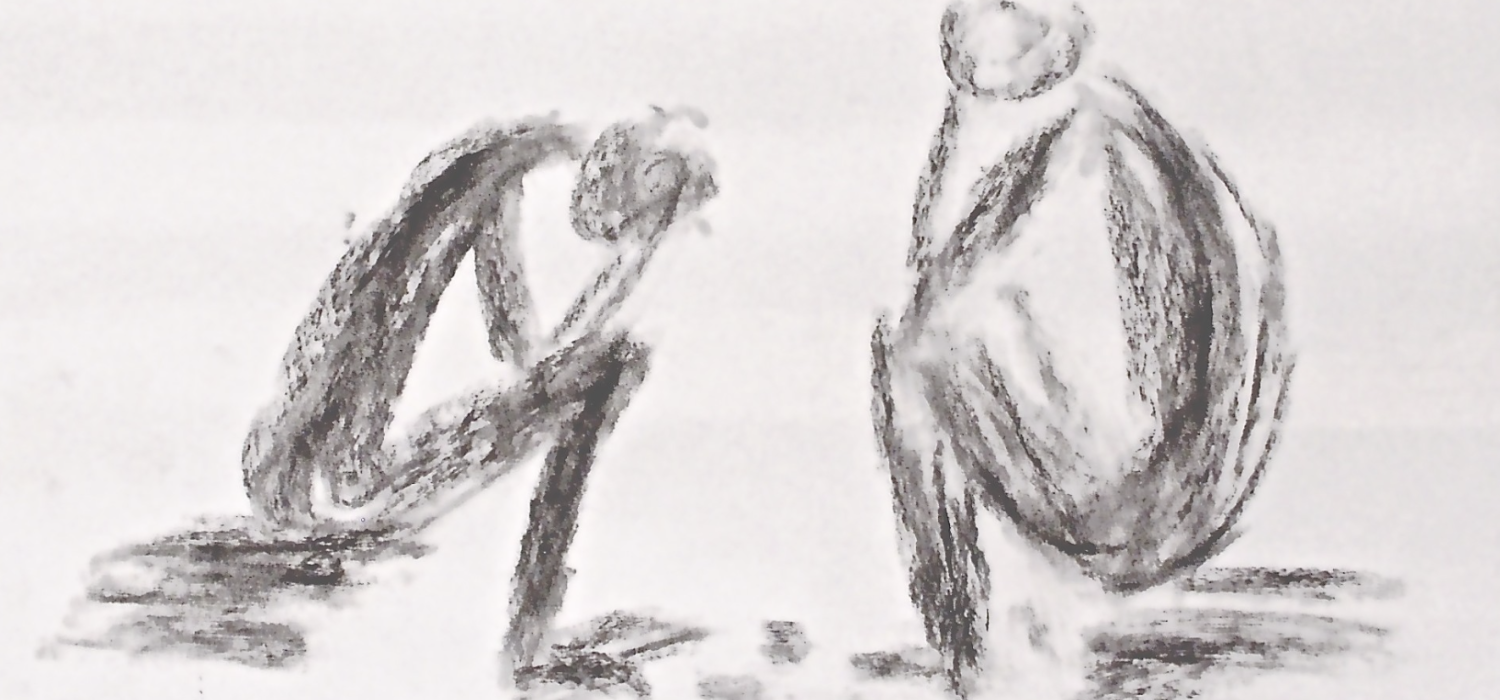Retour sur 7 années d’une aventure humaine et sociale
Entre 2009 et 2016, le cabinet Deffontaines a mené à Amiens une action d’accompagnement et de transformation d’un quartier populaire, axée sur la participation citoyenne et des acteurs locaux. Ce projet, qui finalement a impliqué environ 500 personnes, a été financé principalement par la collectivité et soutenu par l’État. On peut le voir comme la genèse du projet des « oubliés de la politique », en voici les résultats.
ORIGINES ET METHODES
La genèse du projet
Un constat. Celui d’un besoin de démocratie, du besoin d’impliquer davantage les acteurs locaux dans la prise de décision et dans son exécution pratique. Le constat d’une légitimité pas toujours certaine ni centrale. Une perception variable selon les habitants, les milieux, et les institutions, avec une complexité dans les relations mutuelles.
Dans ce contexte, en 2008, la municipalité amiénoise décide de nommer un premier adjoint au maire, responsable de la démocratie et de la participation citoyenne. Aussitôt nommé, il se met au travail et sollicité le cabinet Deffontaines pour une rencontre. La discussion est lancée, le sujet est identifié, et après les étapes protocolaires il est décidé de lancer en mai 2009, devant une cinquantaine de personnes, un projet complexe.
C’est le début de sept années d’une aventure humaine et sociale.
Des objectifs simples mais une complexité de mise en application
L’ambition initiale du projet est simple :
- Provoquer la rencontre entre habitants, professionnels et institutions ;
- Construire de nouvelles formes de coopération, au-delà des préjugés ;
- Redonner de la légitimité à ceux qui se sentent impuissants ;
- Initier un processus démocratique participatif, dans une logique de réseau plus que de structure figée
Si ces objectifs paraissent évidents sur le papier, le processus s’est construit lentement, parfois laborieusement. Il a fallu surmonter les difficultés de mobilisation, les méfiances, les tensions historiques, notamment autour de la police, les institutions, la précarité ou encore le sentiment d’abandon. Ce qui a commencé autour d’a priori naturels entre les uns et les autres, a fini par un projet fait de mixités culturelles, de blessures sociales, de clans, mais finalement d’une forte richesse humaine.

La méthode et le rôle de l’intervenant
La première étape de ce projet a été celle de l’intervenant et de sa réflexion sur son rôle, son positionnement et sa légitimité. Dans ce projet, Bruno Deffontaines, au travers du cabinet Deffontaines, s’est positionné comme un « guérisseur blessé » qui utilise ses fragilités comme atout. Le parcours de ce dernier et sa propre construction lui permettent de comprendre la dualité, et de réduire la distance entre l’intervenant et les participants du projet.
Somme toute, c’est de la thérapie sociale comme outil de médiation dont il est objet dans ce travail. Elle repose sur :
- La reconnaissance de l’imperfection comme vecteur d’authenticité ;
- Le travail en réseau, plutôt qu’en silo ;
- L’acceptation du chaos comme terreau de réinvention
- La distance réflexive, permise par la supervision régulière
L’intervenant se positionne comme un « homme de l’entre-deux », ni extérieur, ni complètement intégré, capable d’incarner une fonction d’interprète entre institutions et terrain. C’est la force du projet et c’est ce qui a permis sa vitalité pendant 7 années.
LE PROJET
Après la mise en place institutionnelle du projet, ce dernier a enfin pu commencer en 2009. Le protocole évacué, place à l’action.
2009-2010 : Apprendre à se connaitre, construire son réseau, se comprendre
En Mai 2009, une première réunion a lieu en mairie. Sont présents une cinquantaine de personnes, incluant élus et responsables associatifs. Des petits groupes se mettent en place, l’échange est ainsi favorisé par l’éclatement et la mise en dialogue. Il faut apprendre à oser, apprendre à se tromper, déconstruire ses représentations et préjugés. Le projet démarre.
Cette première rencontre donne suite à une deuxième. Cette fois-ci, il faut sortir des institutions et de la zone de confort. Une tente est installée dans un quartier populaire pour cadrer la rencontre. Une nouvelle fois, une cinquantaine de participants mais peu d’intérêt pour les exercices proposés. Les échanges sont spontanés mais peu constructifs : ils font part de revendication personnelles. La réalité du terrain s’installe, tâche à l’animateur de ne pas se laisser déborder par son ressenti premier.
Au fil du temps, le constat se solidifie : il est difficile de mobiliser et de dépasser la méfiance des nouveaux acteurs que représentent les intervenants sur le quartier. Les acteurs associatifs, en plus des habitants, représentent un défi supplémentaire puisqu’il s’agit pour eux de ne pas être perturbés dans leur action. La disponibilité des uns et des autres est un véritable sujet.
Le point de déblocage va être la création d’alliance pour créer de l’engagement. Il faut créer des alliances basées sur les intérêts communs, en comprenant les motivations individuelles pour susciter de l’engagement, peu importe leur nature. De là, un réseau d’acteurs s’est progressivement construit et a facilité la communication et le déroulement du projet. L’animateur doit régulièrement, en parallèle, rencontrer ceux qui ne participent pas aux réunions. Le rôle de l’informel est primordial, ainsi que celui de la légitimité des participants lors des décisions.

De là, le projet évolue lentement mais surement. Au total, une trentaine de rencontres collectives, une confiance qui se renforce mais toujours fragile du fait des rivalités existantes, et des habitants qui se sentent écoutés mais toujours inquiets sur la prise en compte de leurs besoins. La solution trouvée a été la mise en place de groupes de coopération pour coconstruire des projets concrets dans le quartier. L’ouverture vers l’extérieur est ainsi garantie et le sentiment d’isolement limité. L’albatros est choisi comme lieu de mise en pratique des projets, un cadre commence à se dessiner, c’est la deuxième phase du projet.
2010 – 2012 : Les débuts du collectif Albatros
Septembre 2010, un groupe se structure et fonde le « collectif Albatros », avec un fort accent mis sur la co-construction des projets entre membres. Le mode de fonctionnement démocratique instauré vise à éviter que le collectif ne devienne un simple fournisseur de services pour les usagers, un « supermarché de propositions ». Une part importante est donnée à la gestion des conflits et à la reconnaissance de la légitimé de chaque membre.
Pour la gestion pratique et les subventions, l’APAP prend la gestion du quotidien mais elle ne chapote pas la vie du projet et ses évolutions.
Sa première action d’ampleur est l’accompagnement des enfants. En lien avec les écoles et les acteurs locaux, plus de 200 enfants auront été inscrits dans le collectif. Il ne s’agit pas que de proposer de l’aide aux devoirs mais de créer un véritable réseau pour ces enfants et pour les parents. Les étudiants du quartier participent au projet et les mères s’organisent sur ce temps et effectuent également des activités. Au-delà des enfants, les jeunes aussi se fédèrent et planifient des événements. Leur accompagnement est d’ailleurs un des points centraux du projet.
L’outil a été créé, les habitants s’en sont saisis. Il doit rester souple et fluctuant pour permettre de s’adapter à chacun. Chaque semaine, le groupe se réunit d’une manière ou d’une autre. Ces espaces de rencontre et les réunions régulières permettent d’échanger et réguler les propositions. Toutefois, certains membres, comme les policiers municipaux, ont plus de difficulté à trouver leur place. Cela dit, les acteurs qui n’ont pas comme fonction la relation, sont moins présents au quotidien mais participent toujours sur des sujets spécifiques. La question de l’autorité et de la légitimité est centrale dans les discussions. Pour autant, le collectif avance.

Les conflits représentent une part importante de la vie du collectif. Une association d’artiste, par exemple, a proposé de travailler avec le collectif. Mais l’épisode d’une réunion organisée sans le régulateur, Bruno Deffontaines, vient mettre à mal le principe de co-construction et créer un malaise. Cet exemple, important, est celui d’une réunion organisée pour un projet en parallèle du collectif, où la majorité des acteurs a été conviée sauf le régulateur. C’est l’exemple d’une perception où l’intervenant est vu comme « trop présent » et où le collectif veut s’auto-gérer mais pas coconstruire.
Ce ne sera toutefois pas la fin du projet, qui continuera d’évoluer.
2012 : Les émeutes et leurs conséquences sur le projet
En août 2012, Amiens a connu un épisode d’émeutes qui s’est cristallisé dans la nuit du 13 au 14 août par la destruction d’une école et une salle de sport. Cet épisode a eu un impact majeur sur le quartier, exacerbant les tensions et les clivages présents entre les différents acteurs. Elle a mis en lumière les défis sur la sécurité et la présence professionnelle dans l’espace public. La reprise des activités du collectif a été marquée par un besoin d’échange et d’engagement.
Des distances ont été prises avec l’association qui gère la trésorerie et les subventions du projet, du fait de tensions entre les uns et les autres.
Amiens est choisie comme territoire pilote pour mener une politique publique générale, et de nombreuses visites de ministres et d’officiels ont lieu dans les mois à venir. L’absence de professionnels dans l’espace public a contribué à l’insécurité, mais la présence brutale d’officiels n’arrange pas les choses directement.
Il est donc fait la proposition au collectif de rassembler les acteurs autour de la question de la présence dans l’espace public, qu’elle soit officielle ou non. Une dynamique collective est renforcée, notamment par la présence des institutionnels et des associatifs. Mis en place en 2011, les repas partagés sont poursuivis en 2012. Des repas sont organisés chaque mardi, et un gros repas mensuel est organisé par les femmes du quartier.
Des habitants ont quitté le quartier suite aux émeutes, mais de nouvelles personnes s’impliquent. Le projet est organique, il vit.

2013-2014 : Le collectif Albatros, le quartier vit, un projet de ville se dessine pour les municipales
Un groupe de travail est créé, en 2013, pour favoriser la collaboration entre habitants, associations et institutions dans le quartier. Ce groupe est composé de 60 acteurs (1/3 d’habitants, 1/3 d’associatifs, 1/3 d’institutionnels), les thèmes centraux sont le respect, la citoyenneté, l’injustice et le construire ensemble. Les difficultés persistent, un paradoxe se créée entre la lassitude d’une grande partie des participants, et la volonté de changer et de bouger. Ce sentiment survient à la suite des émeutes.
Pourtant, le collectif avance. Le groupe formule des propositions concrète pour améliorer la vie dans le quartier, certaines sont évidemment abandonnées faute de portage sérieux, mais d’autres sont menées à terme. On peut citer par exemple un projet sur les relations police-jeunes lancée en 2015, soutenu par la Préfecture. Un autre, en lien avec la préfecture et la mairie, sur la question de la transversalité entre les acteurs de terrain qui travaillent avec les jeunes et l’analyse des pratiques.
À l’Automne 2013, les assises de la politique de la ville mettent en lumière l’importance de la participation des habitants. La légitimité du projet est ainsi validée. Cependant la période électorale ne permet pas à la ville de pérenniser notre initiative. Il faudra attendre 2016 pour valider.
Entre temps, l’association réintègre le collectif de manière plus distanciée. Les activités d’accompagnement scolaire continuent, mais ne se développement plus. Les rencontres du collectif continuent. Des tensions persistent autour de la gestion de l’espace et des ressources. Des ateliers s’ouvrent pour accueillir les habitants en difficulté, mais il est difficile de maintenir de l’engagement sur le long terme.
Les participants ont peur que le collectif meure au printemps 2014, après les élections. Il faut réfléchir à l’après si le projet n’est plus financé.

2014 – 2015 : L’après municipales
23 et 30 mars 2014. Les municipales ont lieu. Changement de municipalité et nouvelle équipe, la gauche fait place au centre. La transition politique entraine retards et incertitudes sur le financement et le soutien des initiatives. Un engagement verbal est donné pour poursuivre le projet, mais des complications s’installent. Entre temps, le cabinet Deffontaines annonce son départ du projet pour juin 2015. De nouveaux défis se présentent.
Une formation d’analyse des pratiques professionnelles pour les médiateurs sociaux, animateurs jeunesse et animateurs sportifs se met en place. Elle avait été décidée précédemment, mais commence à partir d’octobre 2014 avec un groupe de 12 personnes. Des tensions sont engendrées, mais la formation est menée à terme. Un groupe de chefs de services, afin qu’ils comprennent les enjeux de la formation, est mis en place en avril 2015 et se réunit quatre fois.
Le projet d’amélioration des relations entre jeunes et policiers, imaginé en mai 2013, est mis en œuvre début 2015. Un groupe de six jeunes et sept policiers se réunissent pendant quatre demi-journées. L’objectif est de favoriser la rencontre et construire des alternatives d’expression. En plus des questions de préventions, différents sujets plus profonds sont abordés. En ressortent des réflexions sur la question du pouvoir et de l’impuissance, les rapports de force, la liberté de parole. Au-delà des propositions, une campagne de communication est proposée, une fête autour de la prévention ou encore un concours de création de mini-clips par les jeunes. Les propositions faites par le groupe sont financées par l’État, le projet se poursuit en 2015-2016, le groupe de jeunes et de policiers se constituant en comité de suivi. Malheureusement, les attentats du bataclan surviennent et le projet, qui avait pour objectif de se développer à grande échelle, est mis à l’arrêt.
En parallèle, le collectif Albatros continue de fonctionner. En janvier 2015 une association est créée, avec un bureau resserré, pour accéder à des financements. Les réunions continuent chaque semaine pour débattre des actions du collectif. Les enjeux de pouvoir et de démocratie sont centraux.
Comme prévu, le cabinet Deffontaines a quitté le projet en 2016. Le collectif albatros existe toujours mais fonctionne différemment.
LES CONCLUSIONS
Les clivages
L’un des points majeurs de cette expérience, et qui a jalonné sa progression du début à la fin, c’est la présence de clivages et la complexité des relations entre acteurs. Les clivages ont une fonction importante dans notre société, ils se reflètent donc nécessairement à l’échelle d’un collectif ou d’un quartier. Les relations au sein d’un collectif sont marquées par des enjeux émotionnels et stratégiques, avec des alliances fluctuantes. La dynamique de pouvoir et les tensions interpersonnelles influencent le fonctionnement du groupe.
Les clans se forment et se déforment selon les intérêts personnels. Les enjeux de reconnaissance et de légitimité sont centraux dans les interactions. La fragilité de l’association nécessite une attention particulière pour éviter les dérives.

Réseaux & méritocratie
Les réseaux d’appartenance jouent un rôle crucial dans la réussite individuelle et collective au sein des quartiers, souvent en opposition à la méritocratie. Ils peuvent offrir soutien et opportunités, mais aussi créer des inégalités et des sentiments d’injustice. L’appartenance à un groupe procure reconnaissance et sécurité, et les réseaux facilitent l’accès à l’emploi, là où le manque de réseau constitue un obstacle majeur. Les pratiques de copinage et de favoritisme dans les recrutements alimentent la défiance envers les institutions. Les réseaux déviants prospèrent malgré la répression, offrant des alternative économiques. La création d’une fraternité pourrait contrer les effets négatifs des réseaux dits mercantiles, axés autour du don et de la dette.
Quant à elle, la méritocratie repose sur l’idée que le travail acharné mène à la réussite. Les inégalités d’environnement influencent directement les chances de succès. De nombreux diplômés peinent à s’insérer sur le marché du travail, alimentant le scepticisme envers l’effort. La rigidité du système éducatif privilégie la docilité au détriment de la créativité. La confrontation entre méritocratie et réseaux crée des tensions idéologiques. Ce modèle peut se retrouver au sein même des familles, avec un enfant « modèle » et d’autres enfants qui n’arrivent pas à se plier au cadre. Une étude sur la réussite éducative en lien avec l’environnement familial pourrait être pertinente.
La légitimité des acteurs dans le quartier
La question de la légitimité des acteurs, qu’ils soient habitants ou intervenants extérieurs, est centrale dans les dynamiques du pouvoir au sein des quartiers. Les « sachants » et « connaissants » coexistent souvent dans une méfiance mutuelle. Les « sachants » possèdent un savoir théorique souvent perçu comme condescendant par les habitants, là où lest « connaissants » ont une légitimité basée sur leur expérience vécue dans le quartier. De la tension de ces deux groupes résulte une cascade de conflits et d’incompréhensions. Il faut reconnaitre la subjectivité de chaque acteur pour favoriser leur coopération.
L’égocentrisme et le don de soi sont mêlés en permanence dans l’action des acteurs de terrain. La coopération entre acteurs demande d’accepter d’entrer dans la complexité et l’ambivalence de chacun, y compris de soi-même.

Compétition et enjeux de pouvoir dans les relations
Les relations entre acteurs du quartier sont marquées par la compétition et les enjeux de pouvoirs, souvent évincés des discussions ouvertes et non mentionnés. La compétition est pourtant présente dans le financement et les projets associatifs. En parallèle, c’est toute la question de la virilité et de la place de l’homme dans les milieux collectifs qui est à étudier. Les acteurs établissent des alliances stratégiques pour maintenir leur pouvoir, et la peur l’intimidation peuvent influencer les comportements des habitants. La nécessité d’une approche collaborative est essentielle pour surmonter ces tensions. Notons par ailleurs que le milieu associatif en lui-même ne peut plus être aussi spontané qu’auparavant. En ce sens qu’il nécessite plus d’énergie et de structure, puisque pour survivre il faut être compétitif. Difficile donc de recourir à l’immédiateté.
La méfiance
Les rapports entre acteurs du quartier, habitants, associations, politiques et responsables institutionnels est marqué par un mélange de méfiance, connivences, indifférences et intérêts personnels. L’information étant une forme de pouvoir, le réseau est essentiel. Et tous les acteurs n’ont pas la même forme de réseau.
Trouver la justesse et la souplesse entre idéologie et mise en pratique dans une discours entendable pour chacun, permettrait de redonner confiance aux uns et aux autres. Mais la pratique est bien différente. C’est tout l’enjeu du travail de terrain qui a été mené, visant à apporter à tous le même niveau d’implication et d’information.
Le temps
Le rapport au temps est primordial lors de la construction du collectif. Il faut accepter que tous ne soient pas sur le même temps. Les institutions françaises fonctionnent les unes à côté des autres, hiérarchisées, verticales, elles ne sont donc par définition pas sur le même mode de fonctionnement qu’un collectif. Au sein d’un collectif même, la notion de temps est primordiale. Tous ne sont pas disponibles au même moment, tous n’ont pas le même temps à consacrer. Le besoin de réactivité n’a jamais été aussi grand et les normes aussi codifiées. Le travail supplémentaire de chacun pour respecter les procédures crée de la surcharge. L’animateur a pour rôle de cadrer ce temps, et de trouver un compromis.

Apprendre la démocratie représentative et la démocratie participative
La coexistence de la démocratie participative et représentative est essentielle pour impliquer les citoyens dans les décisions qui les concernent. La reconnaissance des besoins des habitants est cruciale pour restaurer la confiance dans les institutions. La légitimité de chacun se pose quand on aborde le sujet de la démocratie.
Les quartiers populaires ne sont pas à l’écart de ces débats autour de la démocratie, pour autant le sentiment d’être le sujet sans être l’acteur du débat est bien présent. La question primordiale est de donner de la place aux personnes qui se sentent délaissées. Leur redonner la parole, les extraire de l’oubli.
La mise en place d’un conseil citoyen est une idée, mais elle n’est pas l’alpha et l’omega. Les quartiers populaires ressentent souvent un décalage entre les discours politiques et leurs réalités.
Un changement radical est nécessaire pour concilier les acteurs et restaurer la confiance. Attention toutefois, chacun a son expertise, il ne s’agit par de mettre les acteurs de terrain et les habitants dans une forme de toute puissance. Il faut trouver la place. Mais quelle place ?
Un bilan
Au-delà des chiffres, ce travail a permis de créer des collectifs (comme celui de l’Albatros principalement), de nouer des alliances improbables, d’ouvrir des espaces de parole et d’espoir dans un quartier souvent qualifié de « prioritaire » voire « à problèmes ». Il a aussi permis d’interroger les institutions sur leurs pratiques et limites.
Au-delà de tout ça, au-delà des actions concrètes, le processus lui-même est devenu une transformation : celle des regards, des postures, des modes d’engagement. Une tentative de réhumanisation du lien social, dans une société fragmentée, a été menée.
Le projet démontrer qu’une transformation collective ne se décrète pas, elle se tisse patiemment par la reconnaissance mutuelle, la traversée des conflits, et le pari de la coopération. Il en ressort une conviction forte : la démocratie locale ne peut émerger que si l’on accepte la complexité humaine comme point de départ du changement.